 |
| Patrick Modiano (sipa) |
Je voudrais vous dire tout simplement combien je suis heureux d’être parmi vous et combien je suis ému de l’honneur que vous m’avez fait en me décernant ce prix Nobel de Littérature.
C’est la première fois que je dois prononcer un discours devant une si nombreuse assemblée et j’en éprouve une certaine appréhension. On serait tenté de croire que pour un écrivain, il est naturel et facile de se livrer à cet exercice. Mais un écrivain – ou tout au moins un romancier – a souvent des rapports difficiles avec la parole. Et si l’on se rappelle cette distinction scolaire entre l’écrit et l’oral, un romancier est plus doué pour l’écrit que pour l’oral. Il a l’habitude de se taire et s’il veut se pénétrer d’une atmosphère, il doit se fondre dans la foule. Il écoute les conversations sans en avoir l’air, et s’il intervient dans celles-ci, c’est toujours pour poser quelques questions discrètes afin de mieux comprendre les femmes et les hommes qui l’entourent. Il a une parole hésitante, à cause de son habitude de raturer ses écrits. Bien sûr, après de multiples ratures, son style peut paraître limpide. Mais quand il prend la parole, il n’a plus la ressource de corriger ses hésitations.
Et puis j’appartiens à une génération où on ne laissait pas parler les enfants, sauf en certaines occasions assez rares et s’ils en demandaient la permission. Mais on ne les écoutait pas et bien souvent on leur coupait la parole. Voilà ce qui explique la difficulté d’élocution de certains d’entre nous, tantôt hésitante, tantôt trop rapide, comme s’ils craignaient à chaque instant d’être interrompus. D’où, sans doute, ce désir d’écrire qui m’a pris, comme beaucoup d’autres, au sortir de l’enfance. Vous espérez que les adultes vous liront. Ils seront obligés ainsi de vous écouter sans vous interrompre et ils sauront une fois pour toutes ce que vous avez sur le cœur.
« Un romancier ne peut jamais être son lecteur »
L’annonce de ce prix m’a paru irréelle et j’avais hâte de savoir pourquoi vous m’aviez choisi. Ce jour-là, je crois n’avoir jamais ressenti de manière aussi forte combien un romancier est aveugle vis-à-vis de ses propres livres et combien les lecteurs en savent plus long que lui sur ce qu’il a écrit. Un romancier ne peut jamais être son lecteur, sauf pour corriger dans son manuscrit des fautes de syntaxe, des répétitions ou supprimer un paragraphe de trop. Il n’a qu’une représentation confuse et partielle de ses livres, comme un peintre occupé à faire une fresque au plafond et qui, allongé sur un échafaudage, travaille dans les détails, de trop près, sans vision d’ensemble.
Curieuse activité solitaire que celle d’écrire. Vous passez par des moments de découragement quand vous rédigez les premières pages d’un roman. Vous avez, chaque jour, l’impression de faire fausse route. Et alors, la tentation est grande de revenir en arrière et de vous engager dans un autre chemin. Il ne faut pas succomber à cette tentation mais suivre la même route. C’est un peu comme d’être au volant d’une voiture, la nuit, en hiver et rouler sur le verglas, sans aucune visibilité. Vous n’avez pas le choix, vous ne pouvez pas faire marche arrière, vous devez continuer d’avancer en vous disant que la route finira bien par être plus stable et que le brouillard se dissipera.
Sur le point d’achever un livre, il vous semble que celui-ci commence à se détacher de vous et qu’il respire déjà l’air de la liberté, comme les enfants, dans la classe, la veille des grandes vacances. Ils sont distraits et bruyants et n’écoutent plus leur professeur. Je dirais même qu’au moment où vous écrivez les derniers paragraphes, le livre vous témoigne une certaine hostilité dans sa hâte de se libérer de vous. Et il vous quitte à peine avez-vous tracé le dernier mot. C’est fini, il n’a plus besoin de vous, il vous a déjà oublié. Ce sont les lecteurs désormais qui le révéleront à lui-même. Vous éprouvez à ce moment-là un grand vide et le sentiment d’avoir été abandonné. Et aussi une sorte d’insatisfaction à cause de ce lien entre le livre et vous, qui a été tranché trop vite. Cette insatisfaction et ce sentiment de quelque chose d’inaccompli vous poussent à écrire le livre suivant pour rétablir l’équilibre, sans que vous y parveniez jamais. à mesure que les années passent, les livres se succèdent et les lecteurs parleront d’une « œuvre ». Mais vous aurez le sentiment qu’il ne s’agissait que d’une longue fuite en avant.
Oui, le lecteur en sait plus long sur un livre que son auteur lui-même. Il se passe, entre un roman et son lecteur, un phénomène analogue à celui du développement des photos, tel qu’on le pratiquait avant l’ère du numérique. Au moment de son tirage dans la chambre noire, la photo devenait peu à peu visible. à mesure que l’on avance dans la lecture d’un roman, il se déroule le même processus chimique. Mais pour qu’il existe un tel accord entre l’auteur et son lecteur, il est nécessaire que le romancier ne force jamais son lecteur – au sens où l’on dit d’un chanteur qu’il force sa voix – mais l’entraîne imperceptiblement et lui laisse une marge suffisante pour que le livre l’imprègne peu à peu, et cela par un art qui ressemble à l’acupuncture où il suffit de piquer l’aiguille à un endroit très précis et le flux se propage dans le système nerveux.
« Chaque nouveau livre, au moment de l’écrire, efface le précédent »
Cette relation intime et complémentaire entre le romancier et son lecteur, je crois que l’on en retrouve l’équivalent dans le domaine musical. J’ai toujours pensé que l’écriture était proche de la musique mais beaucoup moins pure que celle-ci et j’ai toujours envié les musiciens qui me semblaient pratiquer un art supérieur au roman – et les poètes, qui sont plus proches des musiciens que les romanciers. J’ai commencé à écrire des poèmes dans mon enfance et c’est sans doute grâce à cela que j’ai mieux compris la réflexion que j’ai lue quelque part : « C’est avec de mauvais poètes que l’on fait des prosateurs. » Et puis, en ce qui concerne la musique, il s’agit souvent pour un romancier d’entraîner toutes les personnes, les paysages, les rues qu’il a pu observer dans une partition musicale où l’on retrouve les mêmes fragments mélodiques d’un livre à l’autre, mais une partition musicale qui lui semblera imparfaite. Il y aura, chez le romancier, le regret de n’avoir pas été un pur musicien et de n’avoir pas composé Les Nocturnes de Chopin.
Le manque de lucidité et de recul critique d’un romancier vis-à-vis de l’ensemble de ses propres livres tient aussi à un phénomène que j’ai remarqué dans mon cas et dans celui de beaucoup d’autres : chaque nouveau livre, au moment de l’écrire, efface le précédent au point que j’ai l’impression de l’avoir oublié. Je croyais les avoir écrits les uns après les autres de manière discontinue, à coups d’oublis successifs, mais souvent les mêmes visages, les mêmes noms, les mêmes lieux, les mêmes phrases reviennent de l’un à l’autre, comme les motifs d’une tapisserie que l’on aurait tissée dans un demi-sommeil. Un demi-sommeil ou bien un rêve éveillé. Un romancier est souvent un somnambule, tant il est pénétré par ce qu’il doit écrire, et l’on peut craindre qu’il se fasse écraser quand il traverse une rue. Mais l’on oublie cette extrême précision des somnambules qui marchent sur les toits sans jamais tomber.
Dans la déclaration qui a suivi l’annonce de ce prix Nobel, j’ai retenu la phrase suivante, qui était une allusion à la dernière guerre mondiale : « Il a dévoilé le monde de l’Occupation. » Je suis comme toutes celles et ceux nés en 1945, un enfant de la guerre, et plus précisément, puisque je suis né à Paris, un enfant qui a dû sa naissance au Paris de l’Occupation. Les personnes qui ont vécu dans ce Paris-là ont voulu très vite l’oublier, ou bien ne se souvenir que de détails quotidiens, de ceux qui donnaient l’illusion qu’après tout la vie de chaque jour n’avait pas été si différente de celle qu’ils menaient en temps normal. Un mauvais rêve et aussi un vague remords d’avoir été en quelque sorte des survivants. Et lorsque leurs enfants les interrogeaient plus tard sur cette période et sur ce Paris-là, leurs réponses étaient évasives. Ou bien ils gardaient le silence comme s’ils voulaient rayer de leur mémoire ces années sombres et nous cacher quelque chose. Mais devant les silences de nos parents, nous avons tout deviné, comme si nous l’avions vécu.
Paris sous l’Occupation, une ville qui « semblait absente d’elle-même »
Ville étrange que ce Paris de l’Occupation. En apparence, la vie continuait, « comme avant » : les théâtres, les cinémas, les salles de music-hall, les restaurants étaient ouverts. On entendait des chansons à la radio. Il y avait même dans les théâtres et les cinémas beaucoup plus de monde qu’avant-guerre, comme si ces lieux étaient des abris où les gens se rassemblaient et se serraient les uns contre les autres pour se rassurer. Mais des détails insolites indiquaient que Paris n’était plus le même qu’autrefois. à cause de l’absence des voitures, c’était une ville silencieuse – un silence où l’on entendait le bruissement des arbres, le claquement de sabots des chevaux, le bruit des pas de la foule sur les boulevards et le brouhaha des voix. Dans le silence des rues et du black-out qui tombait en hiver vers cinq heures du soir et pendant lequel la moindre lumière aux fenêtres était interdite, cette ville semblait absente à elle-même – la ville « sans regard », comme disaient les occupants nazis. Les adultes et les enfants pouvaient disparaître d’un instant à l’autre, sans laisser aucune trace, et même entre amis, on se parlait à demi-mot et les conversations n’étaient jamais franches, parce qu’on sentait une menace planer dans l’air.
Dans ce Paris de mauvais rêve, où l’on risquait d’être victime d’une dénonciation et d’une rafle à la sortie d’une station de métro, des rencontres hasardeuses se faisaient entre des personnes qui ne se seraient jamais croisées en temps de paix, des amours précaires naissaient à l’ombre du couvre-feu sans que l’on soit sûr de se retrouver les jours suivants. Et c’est à la suite de ces rencontres souvent sans lendemain, et parfois de ces mauvaises rencontres, que des enfants sont nés plus tard. Voilà pourquoi le Paris de l’Occupation a toujours été pour moi comme une nuit originelle. Sans lui je ne serais jamais né. Ce Paris-là n’a cessé de me hanter et sa lumière voilée baigne parfois mes livres.
Voilà aussi la preuve qu’un écrivain est marqué d’une manière indélébile par sa date de naissance et par son temps, même s’il n’a pas participé d’une manière directe à l’action politique, même s’il donne l’impression d’être un solitaire, replié dans ce qu’on appelle « sa tour d’ivoire ». Et s’il écrit des poèmes, ils sont à l’image du temps où il vit et n’auraient pas pu être écrits à une autre époque.
Ainsi le poème de Yeats, ce grand écrivain irlandais, dont la lecture m’a toujours profondément ému : Les cygnes sauvages à Coole. Dans un parc, Yeats observe des cygnes qui glissent sur l’eau :
Le dix-neuvième automne est descendu sur moi
Depuis que je les ai comptés pour la première fois ;
Je les vis, avant d'en avoir pu finir le compte
Ils s'élevaient soudain
Et s'égayaient en tournoyant en grands cercles brisés
Sur leurs ailes tumultueuses
Mais maintenant ils glissent sur les eaux tranquilles
Majestueux et pleins de beauté.
Parmi quels joncs feront-ils leur nid,
Sur la rive de quel lac, de quel étang
Enchanteront-ils d'autres yeux lorsque je m'éveillerai
Et trouverai, un jour, qu'ils se sont envolés ?
Les cygnes apparaissent souvent dans la poésie du XIXe siècle – chez Baudelaire ou chez Mallarmé. Mais ce poème de Yeats n’aurait pas pu être écrit au XIXe siècle. Par son rythme particulier et sa mélancolie, il appartient au XXe siècle et même à l’année où il a été écrit.
Il arrive aussi qu’un écrivain du XXIe siècle se sente, par moments, prisonnier de son temps et que la lecture des grands romanciers du XIXe siècle – Balzac, Dickens, Tolstoï, Dostoïevski – lui inspire une certaine nostalgie. À cette époque-là, le temps s’écoulait d’une manière plus lente qu’aujourd’hui et cette lenteur s’accordait au travail du romancier car il pouvait mieux concentrer son énergie et son attention. Depuis, le temps s’est accéléré et avance par saccades, ce qui explique la différence entre les grands massifs romanesques du passé, aux architectures de cathédrales, et les œuvres discontinues et morcelées d’aujourd’hui. Dans cette perspective, j’appartiens à une génération intermédiaire et je serais curieux de savoir comment les générations suivantes qui sont nées avec l’internet, le portable, les mails et les tweets exprimeront par la littérature ce monde auquel chacun est « connecté » en permanence et où les « réseaux sociaux » entament la part d’intimité et de secret qui était encore notre bien jusqu’à une époque récente – le secret qui donnait de la profondeur aux personnes et pouvait être un grand thème romanesque. Mais je veux rester optimiste concernant l’avenir de la littérature et je suis persuadé que les écrivains du futur assureront la relève comme l’a fait chaque génération depuis Homère…
Et d’ailleurs, un écrivain, comme tout autre artiste, a beau être lié à son époque de manière si étroite qu’il n’y échappe pas et que le seul air qu’il respire, c’est ce qu’on appelle « l’air du temps », il exprime toujours dans ses œuvres quelque chose d’intemporel. Dans les mises en scène des pièces de Racine ou de Shakespeare, peu importe que les personnages soient vêtus à l’antique ou qu’un metteur en scène veuille les habiller en bluejeans et en veste de cuir. Ce sont des détails sans importance. On oublie, en lisant Tolstoï, qu’Anna Karénine porte des robes de 1870 tant elle nous est proche après un siècle et demi. Et puis certains écrivains, comme Edgar Poe, Melville ou Stendhal, sont mieux compris deux cents ans après leur mort que par ceux qui étaient leurs contemporains.
« Tolstoï se confondait avec le ciel et le paysage qu’il décrivait »
En définitive, à quelle distance exacte se tient un romancier ? En marge de la vie pour la décrire, car si vous êtes plongé en elle – dans l’action – vous en avez une image confuse. Mais cette légère distance n’empêche pas le pouvoir d’identification qui est le sien vis-à-vis de ses personnages et celles et ceux qui les ont inspirés dans la vie réelle. Flaubert a dit : « Madame Bovary, c’est moi ». Et Tolstoï s’est identifié tout de suite à celle qu’il avait vue se jeter sous un train une nuit, dans une gare de Russie. Et ce don d’identification allait si loin que Tolstoï se confondait avec le ciel et le paysage qu’il décrivait et qu’il absorbait tout, jusqu’au plus léger battement de cil d’Anna Karénine. Cet état second est le contraire du narcissisme car il suppose à la fois un oubli de soi-même et une très forte concentration, afin d’être réceptif au moindre détail. Cela suppose aussi une certaine solitude. Elle n’est pas un repli sur soi-même, mais elle permet d’atteindre à un degré d’attention et d’hyper-lucidité vis-à-vis du monde extérieur pour le transposer dans un roman.
J’ai toujours cru que le poète et le romancier donnaient du mystère aux êtres qui semblent submergés par la vie quotidienne, aux choses en apparence banales, – et cela à force de les observer avec une attention soutenue et de façon presque hypnotique. Sous leur regard, la vie courante finit par s’envelopper de mystère et par prendre une sorte de phosphorescence qu’elle n’avait pas à première vue mais qui était cachée en profondeur. C’est le rôle du poète et du romancier, et du peintre aussi, de dévoiler ce mystère et cette phosphorescence qui se trouvent au fond de chaque personne. Je pense à mon cousin lointain, le peintre Amedeo Modigliani dont les toiles les plus émouvantes sont celles où il a choisi pour modèles des anonymes, des enfants et des filles des rues, des servantes, de petits paysans, de jeunes apprentis. Il les a peints d’un trait aigu qui rappelle la grande tradition toscane, celle de Botticelli et des peintres siennois du Quattrocento. Il leur a donné ainsi – ou plutôt il a dévoilé – toute la grâce et la noblesse qui étaient en eux sous leur humble apparence. Le travail du romancier doit aller dans ce sens-là. Son imagination, loin de déformer la réalité, doit la pénétrer en profondeur et révéler cette réalité à elle-même, avec la force des infrarouges et des ultraviolets pour détecter ce qui se cache derrière les apparences. Et je ne serais pas loin de croire que dans le meilleur des cas le romancier est une sorte de voyant et même de visionnaire. Et aussi un sismographe, prêt à enregistrer les mouvements les plus imperceptibles.
J’ai toujours hésité avant de lire la biographie de tel ou tel écrivain que j’admirais. Les biographes s’attachent parfois à de petits détails, à des témoignages pas toujours exacts, à des traits de caractère qui paraissent déconcertants ou décevants et tout cela m’évoque ces grésillements qui brouillent certaines émissions de radio et rendent inaudibles les musiques ou les voix. Seule la lecture de ses livres nous fait entrer dans l’intimité d’un écrivain et c’est là qu’il est au meilleur de lui-même et qu’il nous parle à voix basse sans que sa voix soit brouillée par le moindre parasite.
Mais en lisant la biographie d’un écrivain, on découvre parfois un événement marquant de son enfance qui a été comme une matrice de son œuvre future et sans qu’il en ait eu toujours une claire conscience, cet événement marquant est revenu, sous diverses formes, hanter ses livres. Aujourd’hui, je pense à Alfred Hitchcock, qui n’était pas un écrivain mais dont les films ont pourtant la force et la cohésion d’une œuvre romanesque. Quand son fils avait cinq ans, le père d’Hitchcock l’avait chargé d’apporter une lettre à un ami à lui, commissaire de police. L’enfant lui avait remis la lettre et le commissaire l’avait enfermé dans cette partie grillagée du commissariat qui fait office de cellule et où l’on garde pendant la nuit les délinquants les plus divers. L’enfant, terrorisé, avait attendu pendant une heure, avant que le commissaire ne le délivre et ne lui dise : « Si tu te conduis mal dans la vie, tu sais maintenant ce qui t’attend. » Ce commissaire de police, qui avait vraiment de drôles de principes d’éducation, est sans doute à l’origine du climat de suspense et d’inquiétude que l’on retrouve dans tous les films d’Alfred Hitchcock.
« C’est beaucoup plus tard que mon enfance m’a paru énigmatique »
Je ne voudrais pas vous ennuyer avec mon cas personnel mais je crois que certains épisodes de mon enfance ont servi de matrice à mes livres, plus tard. Je me trouvais le plus souvent loin de mes parents, chez des amis auxquels ils me confiaient et dont je ne savais rien, et dans des lieux et des maisons qui se succédaient. Sur le moment, un enfant ne s’étonne de rien, et même s’il se trouve dans des situations insolites, cela lui semble parfaitement naturel. C’est beaucoup plus tard que mon enfance m’a paru énigmatique et que j’ai essayé d’en savoir plus sur ces différentes personnes auxquelles mes parents m’avaient confié et ces différents lieux qui changeaient sans cesse. Mais je n’ai pas réussi à identifier la plupart de ces gens ni à situer avec une précision topographique tous ces lieux et ces maisons du passé. Cette volonté de résoudre des énigmes sans y réussir vraiment et de tenter de percer un mystère m’a donné l’envie d’écrire, comme si l’écriture et l’imaginaire pourraient m’aider à résoudre enfin ces énigmes et ces mystères.
Et puisqu’il est question de « mystères », je pense, par une association d’idées, au titre d’un roman français du XIXe siècle : Les mystères de Paris. La grande ville, en l’occurrence Paris, ma ville natale, est liée à mes premières impressions d’enfance et ces impressions étaient si fortes que, depuis, je n’ai jamais cessé d’explorer les « mystères de Paris ». Il m’arrivait, vers neuf ou dix ans, de me promener seul, et malgré la crainte de me perdre, d’aller de plus en plus loin, dans des quartiers que je ne connaissais pas, sur la rive droite de la Seine. C’était en plein jour et cela me rassurait. Au début de l’adolescence, je m’efforçais de vaincre ma peur et de m’aventurer la nuit, vers des quartiers encore plus lointains, par le métro. C’est ainsi que l’on fait l’apprentissage de la ville et, en cela, j’ai suivi l’exemple de la plupart des romanciers que j’admirais et pour lesquels, depuis le XIXe siècle, la grande ville – qu’elle se nomme Paris, Londres, Saint-Pétersbourg, Stockholm – a été le décor et l’un des thèmes principaux de leurs livres.
Edgar Poe dans sa nouvelle L’homme des foules a été l’un des premiers à évoquer toutes ces vagues humaines qu’il observe derrière les vitres d’un café et qui se succèdent interminablement sur les trottoirs. Il repère un vieil homme à l’aspect étrange et il le suit pendant la nuit dans différents quartiers de Londres pour en savoir plus long sur lui. Mais l’inconnu est « l’homme des foules » et il est vain de le suivre, car il restera toujours un anonyme, et l’on n’apprendra jamais rien sur lui. Il n’a pas d’existence individuelle, il fait tout simplement partie de cette masse de passants qui marchent en rangs serrés ou bien se bousculent et se perdent dans les rues.
« Grâce à la topographie d’une ville, c’est toute votre vie qui vous revient à la mémoire »
Et je pense aussi à un épisode de la jeunesse du poète Thomas De Quincey, qui l’a marqué pour toujours. À Londres, dans la foule d’Oxford Street, il s’était lié avec une jeune fille, l’une de ces rencontres de hasard que l’on fait dans une grande ville. Il avait passé plusieurs jours en sa compagnie et il avait dû quitter Londres pour quelque temps. Ils étaient convenus qu’au bout d’une semaine, elle l’attendrait tous les soirs à la même heure au coin de Tichfield Street. Mais ils ne se sont jamais retrouvés. « Certainement nous avons été bien des fois à la recherche l’un de l’autre, au même moment, à travers l’énorme labyrinthe de Londres ; peut-être n’avons-nous été séparés que par quelque 18 mètres – il n’en faut pas davantage pour aboutir à une séparation éternelle. »
Pour ceux qui y sont nés et y ont vécu, à mesure que les années passent, chaque quartier, chaque rue d’une ville, évoque un souvenir, une rencontre, un chagrin, un moment de bonheur. Et souvent la même rue est liée pour vous à des souvenirs successifs, si bien que grâce à la topographie d’une ville, c’est toute votre vie qui vous revient à la mémoire par couches successives, comme si vous pouviez déchiffrer les écritures superposées d’un palimpseste. Et aussi la vie des autres, de ces milliers et milliers d’inconnus, croisés dans les rues ou dans les couloirs du métro aux heures de pointe.
C’est ainsi que dans ma jeunesse, pour m’aider à écrire, j’essayais de retrouver de vieux annuaires de Paris, surtout ceux où les noms sont répertoriés par rues avec les numéros des immeubles. J’avais l’impression, page après page, d’avoir sous les yeux une radiographie de la ville, mais d’une ville engloutie, comme l’Atlantide, et de respirer l’odeur du temps. à cause des années qui s’étaient écoulées, les seules traces qu’avaient laissées ces milliers et ces milliers d’inconnus, c’était leurs noms, leurs adresses et leurs numéros de téléphone. Quelquefois, un nom disparaissait, d’une année à l’autre. Il y avait quelque chose de vertigineux à feuilleter ces anciens annuaires en pensant que désormais les numéros de téléphone ne répondraient pas. Plus tard, je devais être frappé par les vers d’un poème d’Ossip Mandelstam :
Je suis revenu dans ma ville familière jusqu'aux sanglots
Jusqu'aux ganglions de l'enfance, jusqu'aux nervures sous la peau.
Pétersbourg ! [...]
De mes téléphones, tu as les numéros.
Pétersbourg ! J'ai les adresses d'autrefois
Où je reconnais les morts à leurs voix.
Oui, il me semble que c’est en consultant ces anciens annuaires de Paris que j’ai eu envie d’écrire mes premiers livres. Il suffisait de souligner au crayon le nom d’un inconnu, son adresse et son numéro de téléphone et d’imaginer quelle avait été sa vie, parmi ces centaines et ces centaines de milliers de noms.
On peut se perdre ou disparaître dans une grande ville. On peut même changer d’identité et vivre une nouvelle vie. On peut se livrer à une très longue enquête pour retrouver les traces de quelqu’un, en n’ayant au départ qu’une ou deux adresses dans un quartier perdu. La brève indication qui figure quelquefois sur les fiches de recherche a toujours trouvé un écho chez moi : Dernier domicile connu. Les thèmes de la disparition, de l’identité, du temps qui passe sont étroitement liés à la topographie des grandes villes. Voilà pourquoi, depuis le XIXe siècle, elles ont été souvent le domaine des romanciers et quelques-uns des plus grands d’entre eux sont associés à une ville : Balzac et Paris, Dickens et Londres, Dostoïevski et Saint-Pétersbourg, Tokyo et Nagaï Kafû, Stockholm et Hjalmar Söderberg.
J’appartiens à une génération qui a subi l’influence de ces romanciers et qui a voulu, à son tour, explorer ce que Baudelaire appelait « les plis sinueux des grandes capitales ». Bien sûr, depuis cinquante ans, c’est-à-dire l’époque où les adolescents de mon âge éprouvaient des sensations très fortes en découvrant leur ville, celles-ci ont changé. Quelques-unes, en Amérique et dans ce qu’on appelait le tiers-monde, sont devenues des « mégapoles » aux dimensions inquiétantes. Leurs habitants y sont cloisonnés dans des quartiers souvent à l’abandon, et dans un climat de guerre sociale. Les bidonvilles sont de plus en plus nombreux et de plus en plus tentaculaires. Jusqu’au XXe siècle, les romanciers gardaient une vision en quelque sorte « romantique » de la ville, pas si différente de celle de Dickens ou de Baudelaire. Et c’est pourquoi j’aimerais savoir comment les romanciers de l’avenir évoqueront ces gigantesques concentrations urbaines dans des œuvres de fiction.
Être né en 1945 « m’a rendu plus sensible aux thèmes de la mémoire et de l’oubli »
Vous avez eu l’indulgence de faire allusion concernant mes livres à « l’art de la mémoire avec lequel sont évoquées les destinées humaines les plus insaisissables ». Mais ce compliment dépasse ma personne. Cette mémoire particulière qui tente de recueillir quelques bribes du passé et le peu de traces qu’ont laissé sur terre des anonymes et des inconnus est elle aussi liée à ma date de naissance : 1945. D’être né en 1945, après que des villes furent détruites et que des populations entières eurent disparu, m’a sans doute, comme ceux de mon âge, rendu plus sensible aux thèmes de la mémoire et de l’oubli.
Il me semble, malheureusement, que la recherche du temps perdu ne peut plus se faire avec la force et la franchise de Marcel Proust. La société qu’il décrivait était encore stable, une société du XIXe siècle. La mémoire de Proust fait ressurgir le passé dans ses moindres détails, comme un tableau vivant. J’ai l’impression qu’aujourd’hui la mémoire est beaucoup moins sûre d’elle-même et qu’elle doit lutter sans cesse contre l’amnésie et contre l’oubli. À cause de cette couche, de cette masse d’oubli qui recouvre tout, on ne parvient à capter que des fragments du passé, des traces interrompues, des destinées humaines fuyantes et presque insaisissables.
Mais c’est sans doute la vocation du romancier, devant cette grande page blanche de l’oubli, de faire ressurgir quelques mots à moitié effacés, comme ces icebergs perdus qui dérivent à la surface de l’océan.
http://www.lemonde.fr/prix-nobel/article/2014/12/07/verbatim-le-discours-de-reception-du-prix-nobel-de-patrick-modiano_4536162_1772031.html
Le 11 octobre 2014, Patrick Modiano était invité à France Culture
http://www.franceculture.fr/emission-l-evenement-modiano-1-entretien-exclusif-patrick-modiano-par-christophe-ono-dit-biot-2014-1











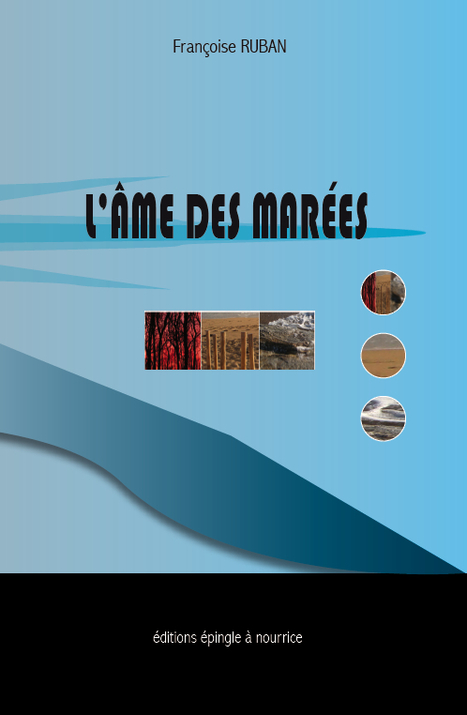



************
*******
Chère Françoise,
Les mots dont tu t'empares te sont des armes pour lutter contre ce qui
a fondu sur toi. Ils m'ont profondément ému car je ne te connaissais
évidemment pas sous ce jour-là. La vie m'a jusqu'à maintenant épargné
une épreuve indélébile comme celle que tu as subie et aussi sans doute
quelques autres que je puis entrevoir et qui t'ont cruellement
guettée. Le plaisir que j'ai eu de te retrouver s'est doublé d'une
découverte, celle d'une femme extrêmement vivante malgré les noirceurs
qui l'environnent et qui, comme moi, a goûté aux merveilles des mots.
Merci de nous avoir fait la confiance de nous permettre de te lire.Ivan K
Quelle beauté d’écriture ! poésie incandescente, élan d’amour et de révolte, tu réussis l’indicible. Comme une prière intérieure, « tes mots s’échappent presque incontrôlés de ton âme », se calligraphient dans cet espace d’intimité dévoilée, pudiquement mais réellement habitée. Chaque vers est musique et chaque note a sa couleur, un sens, un souffle, comme l’inépuisable force de ton cœur.
Face à ta souffrance de mère qui ne cesse de percer le mystère de notre propre existence, …les goélands eux.. savent.. au-delà de la mer éternelle… Ils nous prennent à témoin devant l’océan, ton ami, ton amant, de ce voyage intime au gré des vagues et des marées. Et je pleure ..
Poésie rédemptrice ! tu as trouvé en elle un espace neuf, une vie nouvelle, une Etoile dans la nuit, ton Etoile, la plus belle de la constellation. Comme Job, souffrant et questionnant Dieu, tu partages ton humanité.
Et quand je cherche à faire mien tes mots magiques, je me surprends à les citer tous…Impossible. Il me reste alors un goût de sel, de mer, d’odeurs d’embrun, les sons fracassants des vagues en fureur et surtout… le fil d’Ariane du cordon ombilical, le cordon d’Or.
Couleurs d’automne ou d’hiver printanier :
« Sur le sable mouillé Sur les embruns nacrés,
Sur les ailes des goélands Sur les nuages au firmament
Tu existes »
Tu es libre …
MFZ
Tu sais je n'ai pas pu attendre, j'avais trop hâte de feuilleter et de découvrir ton recueil aussi j'ai entamé la lecture le soir même de son arrivée !
J'ai donc lu, découvert et ma lecture m'a beaucoup rapproché de toi....Puis j'ai voyagé avec l'âme des marées dans les mains puis dans le
cœur. Tes poèmes sont très beaux, ils sont le reflet d'une femme humaine, poétesse qui croit en l'Amour, en la Vie, en l'humanité et qui espère. Plusieurs poèmes expriment les sentiments que j'ai éprouvé et cela me touche beaucoup.. ."On me dit...." Il y en a que j'aime plus particulièrement comme "Vivre ton héritage", j'aime beaucoup la musique également qui émane de tes poèmes. Saches que l'âme des marées ne me quitte pas, je relis au hasard quelques poèmes, souvent le soir et redécouvre d'autres tonalités, d'autres couleurs et d'autres sentiments.
Ton petit mot m'a comblé également Françoise et pour tout cela je te remercie du fond du cœur. Je t'embrasse et surtout continue d'écrire ne t'arrête pas...........SM
Je serais intéressé pour dire votre poésie, en musique. Pourquoi pas lors d'un événement que l'on pourrait peut-être créer, autour d'une présentation de votre recueil, quelque chose comme ça. J'aime dire les mots des autres.
YP
J'aimerai pouvoir dire vos poèmes sur ma musique (comme nous l'avons déjà évoqué) dans un cadre semi-public et j'ai pensé que vous seriez peut-être intéressée pour le faire chez vous en invitant des gens de votre entourage, vos lecteurs, peut-être pourrais je en inviter quelques uns de mon propre entourage. Cela pourrait se faire en plein air, dans votre jardin (Laurence m'a dit que vous en aviez un ) ou dans un autre lieu qui vous tient à cœur. En été ou un peu avant ou après. A vous de voir si cela vous inspire. Ceci a l'avantage de ne pas nécessiter de logistique particulière, ni d'organisation trop lourde. Ce pourrait être une première étape vers quelque chose de plus "officiel" par la suite.
Je pense que je peux impliquer mon ami saxophoniste William. J'ai déjà quelques idées de nouvelles compositions sur lesquelles dire vos poèmes.
YP
C’est un grand plaisir que tu m’aies donné ton livre, j’espérais discerner quelle personne tu étais aujourd’hui. Mes questions se sont trouvées balayées par la qualité de tes poèmes. Emotion, puissance et beauté ont été une magnifique découverte A la lecture des premiers mots, j’étais en attente des autres et j’ai été portée de page en page. C’est simple, musical et profond, et parfois bouleversant aussi. Tu es une vraie belle poétesse. Tes amies ont été bien inspirées de t’inciter à publier.
MK