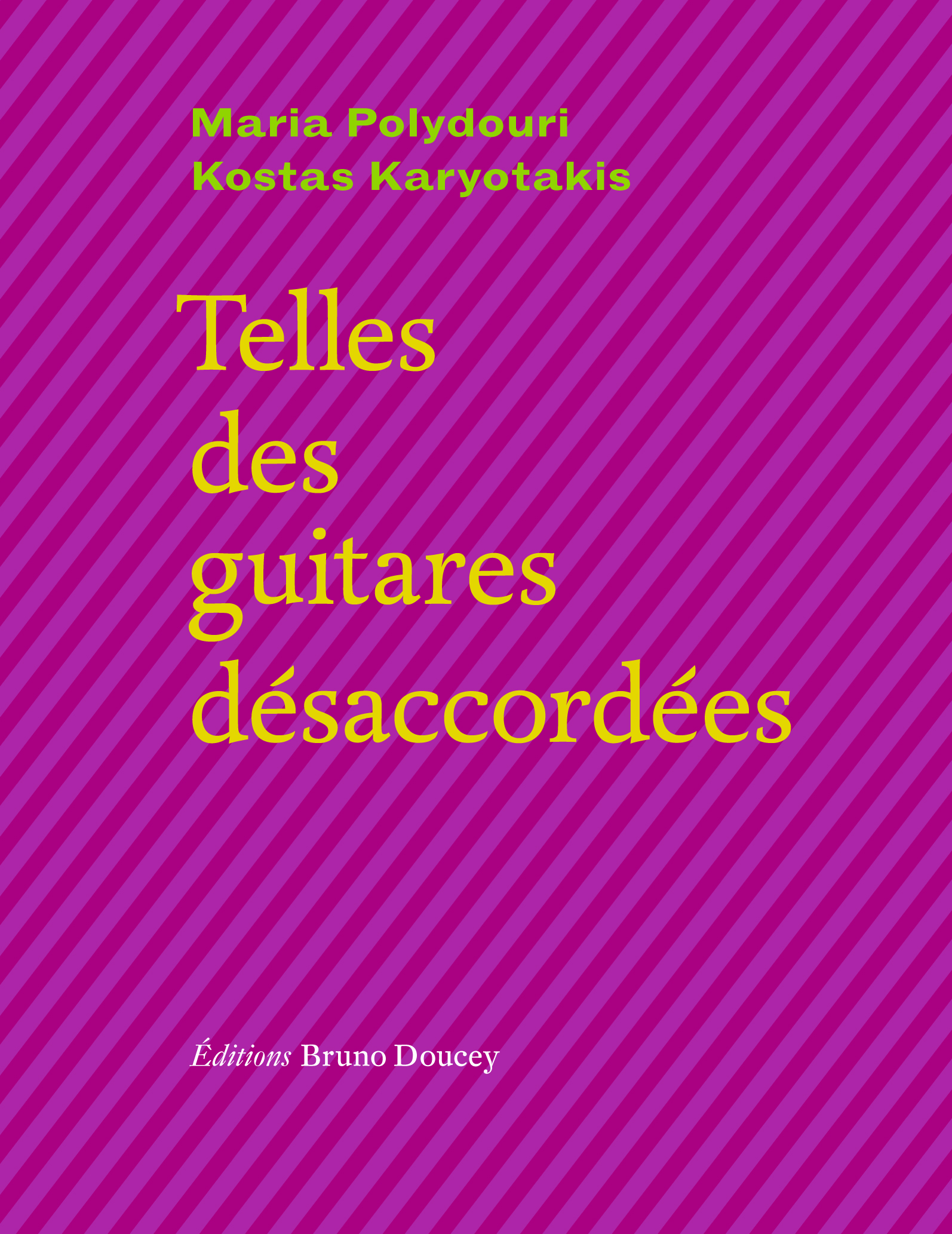Un entretien avec Aslı Erdoğan, par Delphine Minoui, paru dans
Le figaro le 5 janvier. Nous n'avions pas pu vous livrer le contenu, réservé aux abonnés. Il est retranscrit ici, sur le site de l'Institut kurde de Paris.
LE FIGARO. - La prison, que vous n’aviez jamais connue, est le thème central d’un de vos derniers romans,
Le Bâtiment de pierre (traduit et publié en 2013 chez Actes Sud). Vous attendiez-vous à finir, un jour, derrière les barreaux ?
Asli ERDOGAN. - Personne n’est jamais prêt à la prison. Mais, depuis 4-5 ans, j’avais comme un pressentiment. Mes écrits sur les violations des droits de l’homme et les minorités n’ont jamais plu en Turquie. Mais ce qui m’arrive dépasse la fiction : si j’avais inventé mon arrestation, personne ne m’aurait cru. Imaginez une douzaine de membres des forces spéciales qui débarquent chez moi en plein après-midi ! Ils étaient encagoulés, portaient des gilets pare-balles. L’un d’eux a pointé son arme automatique vers ma poitrine en hurlant : tu te rends ou je tire ! On m’a interdit d’appeler qui que ce soit. D’ailleurs, ils ont aussitôt pris mon cellulaire - que je n’ai toujours pas récupéré. Ils ont fouillé mon appartement, saisi mes disques durs, épluché mes documents, renversé les 3 500 livres de ma bibliothèque. La perquisition a duré 8 heures ! J’ai beaucoup d’ouvrages d’histoire, sur les Juifs, sur la Palestine... Mais ils n’ont pris que ceux qui concernaient la question kurde. C’est comme s’ils cherchaient désespérément des pièces à conviction pour m’accuser de lien avec le PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan, considéré comme une organisation terroriste par Ankara, NDLR). J’ai ensuite été embarquée au commissariat, interdite de contact avec ma mère ou mon avocat. Au bout de trois jours, je suis passée devant le juge. Quand il a annoncé que j’étais envoyée en prison, je me suis évanouie.
Quelles sont les charges retenues contre vous ?
On m’accuse d’être membre d’une organisation terroriste armée, de porter atteinte à l’unité de l’État et à l’intégrité territoriale du pays, et de faire de la propagande en faveur d’une organisation terroriste... De quoi être passible de la prison à perpétuité. C’est absurde : je n’ai jamais touché une arme de ma vie. Je ne me suis jamais rendue au mont Qandil (nord de l’Irak, où siège la direction militaire du PKK, NDLR), à l’inverse de nombreux journalistes. Mon seul « crime » est d’avoir siégé au comité éditorial du journal prokurde
Ozgür Giindem, où je signais également des chroniques (dont Actes Sud vient de publier une compilation,
Le silence même n’est plus à toi). Ce qui m’arrive est totalement kafkaïen. Je suis écrivain et ne milite au sein d’aucun parti politique. Le pouvoir turc veut faire de moi un symbole, réduire les autres au silence. Il cherche à faire taire tous ceux qui s’intéressent à la cause kurde. Depuis que les accords de paix ont volé en éclats à l’été 2015, il ne fait plus aucune distinction entre le PKK et les Kurdes.
Vous avez été incarcérée à la prison des femmes de Bakirkôy. Comment s’est passée votre détention ?
Les cinq premiers jours ont été les plus durs à vivre : j’ai été confinée à l’isolement, privée d’eau pendant 48 heures. Ma cellule sentait l’urine. Puis, on m’a transférée dans une section collective, avec 21 autres femmes, toutes accusées de liens avec le PKK. Ma mère ne pouvait me rendre visite qu’une fois par semaine. Quand l’hiver a commencé, il s’est mis à faire très froid. Un jour, je suis tombée malade, j’avais beaucoup de fièvre. C’était un mardi. Mais je n’ai pu accéder à l’infirmerie que le vendredi. Les prisons sont surpeuplées et les surveillants en sous-effectifs. Depuis la purge après la tentative de coup d’État, qui va au-delà des partisans de Gülen (auteur présumé du putsch, NDLR), quelque 50 000 personnes ont été arrêtées. Et puis, il y avait cette rumeur selon laquelle des personnes allaient venir nous attaquer en pleine nuit. On vivait avec la peur. Impossible de fermer l’œil. Mais je sais que la pression internationale m’a permis d’être mieux traitée que d’autres. Je pense à cette femme qui partageait ma cellule au commissariat et que j’ai recroisée brièvement à Bakirkôy : ses jambes et ses bras étaient parcourus d’ecchymoses.
Qu’est-ce qui vous a aidée à tenir en prison ?
Au début, quand il ne faisait pas encore trop froid, je pratiquais mes pas de danse classique dans une petite cour en béton. Je pouvais également disposer de 15 livres, mais pas plus. En prison, tout est quantifié : le nombre de pulls, de pantalons, de carnets de notes. En fait, il est impossible de se concentrer. Les gardes débarquent toujours à l’improviste. Et puis, on est toujours miné par l’inquiétude : sur son sort, sur celui du pays. À la télévision, autorisée dans le foyer central, on assiste, le cœur noué, à la dérive de la Turquie : l’arrestation des journalistes de Cumhuriyet, l’assassinat de l’ambassadeur russe, les attentats, tantôt imputés à Daesh, tantôt au PKK. Quand c’est la guérilla kurde qui est pointée du doigt, les détenues deviennent toutes pâles. Celles qui attendent leur procès craignent que le juge ne soit encore plus sévère. Du coup, cela crée un véritable élan de solidarité entre détenues. À la veille de chaque convocation au tribunal, elles organisent des « soirées de solidarité » : elles boivent du thé, elles chantent. Quand mon tour est venu, elles ont chanté
Bella Ciao. Et je me suis mise à danser en pleurant.
Vos compagnes de prison étaient-elles toutes liées au PKK ?
À part la linguiste Necmiye Alpay (également récemment libérée, NDLR), toutes mes codétenues étaient kurdes. Mais à l’exception de quatre ou cinq d’entre elles, visiblement engagées dans la guérilla, il s’agissait surtout de jeunes femmes, la vingtaine, arrêtées pour un simple lien familial, ou même moins que ça. En revanche, ce qui m’a frappée, c’est la façon dont les plus anciennes organisent la vie de la cellule : l'heure du réveil, du thé, les séances de discussion idéologique. Une discipline quasiment militaire. La prison pousse à la radicalisation politique.
Comment vivez-vous votre liberté retrouvée ?
Avec difficulté. En prison, vous êtes dans un état de régression : tout est décidé et contrôlé par les autres. Une fois dehors, vous redevenez adulte : vous avez un compte bancaire, des rendez-vous, des mails auxquels vous devez répondre. Quant à la peur, elle ne vous quitte pas : peur d’être attaquée dans la rue, peur que la police débarque à tout moment pour vous arrêter. Je loge chez ma mère, je n’ai pas encore osé retourner chez moi. Je suis libre, mais je n’ai pas été acquittée. À chaque nouvelle audience, je sais que le juge peut prononcer de lourdes peines. En fait, une partie de moi-même est toujours en prison.
Traque des opposants, guerre contre le PKK, lutte anti-Daech en Syrie... Que cherche le président Erdogan en ouvrant tant de fronts à la fois ?
Il est prêt à toutes les tactiques pour renforcer son pouvoir, pour que les gens disent : il nous a sauvés. Mais c’est le contraire qui se produit. L’oppression mène à la violence. Si j’étais président, j’essaierai de désamorcer les tensions au lieu de mettre de l’huile sur le feu. Chaque jour apporte une mauvaise nouvelle : un attentat contre une boîte de nuit, un reporter arrêté à cause d’un tweet. Un créateur de mode s’est même fait récemment lyncher à sa sortie d’avion. Sur Internet, les attaques verbales se multiplient. La violence déteint sur la société. C’est très inquiétant. ■
Paru
ICI, Institut kurde de Paris
et aussi sur la page
Free Asli Erdogan
 |
| crédit photo Delphine Minoui, Le Figaro |